Recherche
La gendarmerie sous l’Occupation dans les départements pyrénéens
Jean-François NATIVITÉ
Docteur en histoire
En se pliant aux volontés de Vichy, les gendarmes ont été durant la Seconde Guerre mondiale des instruments de l’ordre au service de la puissance occupante. Pour reprendre l’analyse des deux éthiques définies par le sociologue Max Weber (l’éthique de conviction et éthique de responsabilité), la conscience du gendarme s’est retrouvée prise au piège entre ses propres valeurs humaines – conception encline à souligner ses propres insuffisances et sa culpabilité même relative – et une conviction plus intransigeante et inconditionnelle – celle qui fait agir coûte que coûte – relayée par un légalisme et un respect des ordres érigés en valeurs suprêmes de la condition gendarmique(1). Entre celui qui décide de ne pas se soustraire à des ordres jugés inacceptables, et celui qui préfère rester à son poste avec toutes les ambiguïtés qui en découlent, la marge est parfois difficile à évaluer entre l’homme de conscience et l’homme d’honneur(2) lié à un serment collectif. L’absence de mot d’ordre institutionnel appelant à la dissidence et la mise place d’une allégeance au chef de l’État n’ont fait que confirmer la délicatesse d’un débat renvoyant dos à dos culture militaire et humanité, latitude individuelle.

Gardes républicains mobiles
à la frontière pyrénéenne à la veille
de la Deuxième Guerre mondiale
Faut-il pour autant faire l’amalgame entre cette époque troublée et culpabilité ? Tant s’en faut. Si institutionnellement, l’Arme a subi pendant ces six années de guerre de nombreuses réadaptations somme toute plus traumatisantes in fine, pour ses hommes que pour sa réputation institutionnelle habilement protégée, les tutelles de droit ont eu différentes résonances en fonction des lieux, des contextes et des mentalités de chacun. Pour beaucoup, les changements de régime, les nouvelles missions ou les substitutions d’autorité ont été vécus au travers du filtre du quotidien. Sachant que la direction de l’Arme n’a jamais donné aucune impulsion à une résistance massive aux ordres de l’État français et des Allemands, il a fallu les actes irréparables commis par le régime de Vichy pour éveiller les consciences. La translation d’un engagement originel « honorifique » vers un engagement collectif et institutionnel « de circonstance », a suivi des chemins tortueux passés au crible de la réalité individuelle. De fait, si traumatisme il y eut, c’est plus dans la « logique de situation » individuelle qu’il faut le chercher. Successivement placée entre les mains du gouvernement Daladier, du régime de Vichy et de la tutelle allemande(3), puis soumise au réaménagement transitoire du Commissaire de la République nommé par le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), la gendarmerie aux abords des Pyrénées connut entre 1939 et 1944 des réadaptations radicales de sa structure et de ses missions.
Sous couvert d’un simple respect de la législation, elle dut faire face à diverses convulsions institutionnelles et psychologiques. À l’exception des quelques variations d’effectifs liées aux mutations volontaires ou disciplinaires, les gendarmes, qui avaient désarmé les flots de réfugiés à la frontière franco-espagnole à partir de 1936, furent grosso modo les mêmes(4) qui coopérèrent dès 1939 aux actions anticommunistes consécutives au pacte germano-soviétique, à la surveillance des camps du Sud de la France et qui luttent contre l’évasion des réfractaires du Service du Travail Obligatoire (STO) au printemps 1943. Ce truisme, aussi iconoclaste soit-il pour ceux qui s’acharneraient encore à ne voir dans l’État français qu’une parenthèse de l’histoire de France, sous-tend le problème de continuité et d’héritage qui survit aux changements politiques. Représentants d’un État devenu policier dès l’avènement du gouvernement Darlan, à un moment où les ordres émanent directement ou indirectement de l’occupant, nos gendarmes pyrénéens, partagés entre devoir d’obéissance et exigence patriotique, ont pu vérifier sur place, la sournoise équation mise en exergue par Marc Olivier Baruch : Servir face à l’ennemi ou servir l’ennemi(5). Les tutelles de jure ont connu en fonction des lieux, des contextes et des mentalités de chacun, différentes interprétations. Néanmoins, devant le manque de repères structurels et le joug de la soumission, la réalité du terrain a la plupart du temps fourni des réponses concrètes à la dissonance nationale. Les spécificités pyrénéennes tant géographiques, politiques que culturelles jouèrent ici à plein leurs fonctions intégratrices en prenant le relais d’une dynamique institutionnelle souvent diffuse. Telle une écluse se jouant tour à tour des visées locales, nationales et internationales, les Pyrénées intégrèrent petit à petit les gendarmes locaux dans la logique de guerre qui frappait le pays. Terres historiques de frontières à la fois naturelles et politiques entre les France et l’Espagne, elles furent pour nos gendarmes autant des miroirs grossissants et déformants des événements contextuels aussi bien ressentis que vécus. Après avoir servi de vitrine lugubre aux dernières heures de la république espagnole, elles entrèrent de plain-pied dans la guerre dès l’arrivée des premiers réfugiés fuyant l’avancée allemande. Garrotées jusqu’en novembre 1942 par la ligne de démarcation, elles connurent la césure qui opposa le monde libre et zone occupée. À l’heure d’une redéfinition des enjeux franco-espagnols et méditerranéens liés au conflit, elle fut aussi une zone de contact géostratégique de tout premier plan.
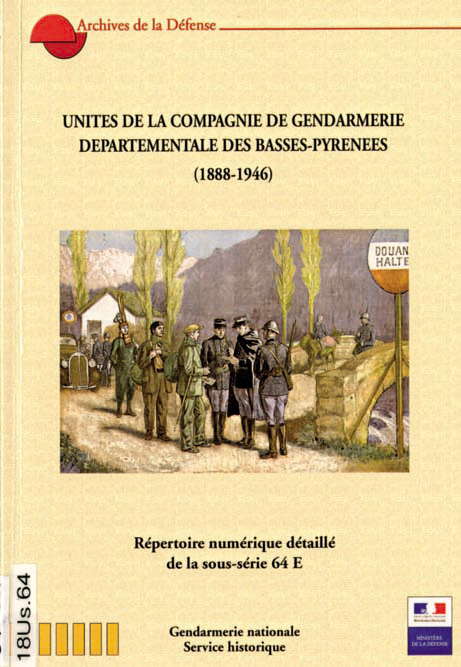
Inventaire des archives
de la gendarmerie des Basses-Pyrénées
Dans une période où la France est engagée dans la Deuxième Guerre mondiale, directement ou indirectement, elle fut confrontée, et pour la première fois depuis les guerres napoléoniennes, à une menace militaire venue d’outre-Pyrénées. Le maintien de la neutralité ibérique devint un objectif prioritaire pour la France entre 1939 et 1944. Les gouvernants français perçurent le problème espagnol comme une affaire secondaire par rapport à l’évolution générale du pays dans la guerre, mais suffisamment importante pour que l’on ne s’en désintéresse pas : le facteur espagnol pouvait à tout moment venir aggraver la situation française. Il fallait donc le contrôler(6). En dépit de la non-belligérance affichée par Franco, la sphère pyrénéenne fut rattrapée par ses prédispositions géographiques et devint pour la durée des hostilités, un lieu de passage et de liberté. Nonobstant son franchissement difficile – ceci est surtout valable pour les Pyrénées centrales – et d’une surveillance renforcée de la part des autorités françaises puis allemandes à partir de novembre 1942, le secteur se transforma après l’instauration du STO, en plaque tournante vers la liberté. Après la libération des territoires pyrénéens, la Reconquista de España lancée depuis le Val d’Aran entre la fin septembre et la mi-novembre 1944, maintint encore la pression sur la zone frontière franco-espagnole en servant de laboratoire à la réaffirmation étatique du gouvernement provisoire, et ce, jusqu’au 16 décembre 1944, date de sa reconnaissance officielle par l’Espagne franquiste. Plus qu’ailleurs, la montagne pyrénéenne proposa un processus historique, une géographie événementielle, qui passa d’un pays à la marge à un lieu d’accueil solidaire de masse lors de la débâcle, de quelques proscrits en 1941-1942, aux jeunes réfractaires du travail obligatoire, puis à son dépassement à travers le support ou le point d’appui montagnard de la petite guerre à outrance des maquisards contre les Allemands et les miliciens de 1944. Elle vit le passage d’un certain archaïsme à la franche modernité, d’une non-histoire du « mauvais gré » contre l’État, à un destin historique exemplaire, d’un huis clos du bout du monde à un temps de géographie de l’espoir et des franchissements, à un lieu d’histoire patriotique puis mondialisé par les radios et la presse, avec ses possibilités et ses limites(7). Le dynamisme de l’événement de guerre bouleversa la sociologie du pays pyrénéen, son genre de vie et son tempérament, en se nourrissant d’abord du pétainisme d’un pays « blanc », moral et patriote, au moins entre 1940 et 1942, puis d’un particularisme vital, « ouranien » et « icarien, de 1941 à 1943, enfin d’un patriotisme jacobin et prométhéen jusqu’à la terreur du feu et du sang, où le terrain du maquis fut l’action même qui offrit un véritable sens héroïque à l’année 1944(8). De fait, au rythme des flux et des reflux de populations, et des cristallisations changeantes de l’opinion publique, la dimension Pyrénéenne à géométrie variable – elle-même contrebalancée par les situations de chaque département – servit de caisse de résonance aux différentes missions gendarmiques. Leurs échos plus ou moins prononcés selon les cas, influencèrent inévitablement le comportement de nos soldats de l’ordre. Ainsi, les coups de projecteur internationaux, de février 1939, du printemps 1943 et de l’automne 1944, constituèrent autant de paliers de décompression comportementaux qui tour à tour, permirent d’adapter et de recadrer leur positionnement, sans jamais se départir de leur légalisme initial.

Camp de réfugiés espagnols
à Argelès en 1939
Dans un contexte de déliquescence institutionnel marqué au fer rouge par la présence de l’occupant, les évolutions du milieu pyrénéen nourrirent la posture du gendarme en lui offrant des échappatoires circonstancielles ou en lui permettant d’attendre que le sort et l’Histoire décident pour eux. Si le caractère sui generis des Pyrénées a au final, fortement intercédé sur une identité gendarmique en plein désarroi, il n’a cependant pas pu empêcher les forfaitures et la faiblesse des hommes ; L’influence du site et de la situation, trouvant ses limites face aux intérêts particuliers ou collectifs du moment. Devant l’étendue du travail qu’il reste à accomplir (notamment en ce qui concerne l’immédiat après-guerre), la compréhension de l’attitude des gendarmes pyrénéens durant la Seconde Guerre mondiale demeure encore aujourd’hui un chantier exploratoire qu’il ne faut en rien galvauder par des conclusions hâtives. Si les premières moissons ont été particulièrement fructueuses, il convient néanmoins de se targuer de la plus grande prudence. À l’heure où les progrès de l’Histoire viennent suppléer une mémoire en mal d’autonomie, les perspectives de reconquête scientifiques paraissent désormais envisageables. Loin des premiers bilans effectués souvent sous la contrainte d’une conjoncture pressante, la réponse est à chercher ailleurs, très certainement du côté des archives des compagnies et des légions de gendarmerie (encore en cours de classement) où l’on retrouve bien souvent pour la période allant de juillet 1944 au printemps 1946 des études de cas et des bilans comportementaux – certes souvent à rédiger à charge ou à décharge – bousculant quelque peu l’opacité administrative des comptes rendus.

Compte tenu des liens de cause à effet existants, pour avancer dans la compréhension du comportement gendarmique des années noires (aussi bien de l’institution que de ses hommes), il nous faudra inévitablement confronter cette vision « affinée » avec l’agrégation des données relatives à l’épuration des sous-officiers et ce, jusqu’au processus de dégagement des cadres amorcé en 1946. Si pour Marc Bergère, l’épuration des officiers de gendarmerie, « par ses pratiques et ses effets, a nourri une crise profonde et durable dans les rangs de l’Arme(9) », la connaissance de ce long processus expiatoire n’en est pourtant qu’à ces débuts. Pour l’heure, les premières esquisses formulées ont surtout permis de mieux appréhender sa dimension organisationnelle. Reste désormais à en étudier les aspects humains sous-jacents, tant sur le plan du vécu et du ressenti quotidien, que de son impact à long terme, en élargissant la focale à l’ensemble du personnel gendarmique. Une certitude cependant, afin de ne pas retomber dans les travers partisans initiaux, l’affranchissement mémoriel ne doit pas céder aux tentations globalisantes anticipées. Pour être efficaces, les ruptures de silence ne peuvent se permettre les erreurs de procédure. La crédibilité des uns et le respect des autres en dépendent. N’en déplaise aux amateurs de procès historiques ou de raccourcis sécuritaires conjoncturels : l’écriture de l’Histoire demande du temps, celui du respect des hommes
(1) Max WEBER, Le savant et le politique, Paris, Union générale d’éditions, 1963, 185 p.
(2) Charles RIST, « Une saison gâtée ». Journal de la Guerre et de l’Occupation 1939-1945, Paris, Fayard, 1983, p. 337.
(3) Si la côte basque est occupée par les Allemands dès le mois de juin 1940, la grande majorité des Pyrénées ne sera confrontée à l’occupant qu’à partir du 11 novembre 1942, date de l’opération Attila.
(4) Au regard des recensements retrouvés dans les registres des compagnies départementales pyrénéennes, la comparaison des effectifs réels (déclarés en activité par le commandant de compagnie) entre le 1er janvier 1936 et le 1er janvier 1943, fait état d’une stabilité de plus de 84 % des personnels officiers et sous-officiers confondus dans le département des Basses-Pyrénées et ce, malgré les changements d’assiette territoriales rendus obligatoire avec la présence allemande. À titre de comparaison, ces chiffres restent très élevés pour les autres départements pyrénéens avec plus de 82 % pour les Hautes-Pyrénées et l’Ariège et respectivement 79 % et 76 % pour les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne.
(5) Marc Olivier BARUCH, Servir l’État français. L’administration en France de 1940 à 1944 (préface de Jean-Pierre AZEMAT), Paris, Fayard, 1997, p. 365.
(6) Michel CATALA, Les relations franco-espagnoles durant la Seconde Guerre mondiale. Rapprochement nécessaire, réconciliation impossible 1939-1944, Paris, l’Harmattan, 1997, p. 331.
(7) Christian GRATELOUP, Lieux d’histoire. Essai de géohistoire systématique, Montpellier, Gip Reclus, 1996, pp. 191-193. Cité par François BOULET, Les Montagnes françaises 1940-1944. des montagnes refuges aux montagnes maquis, Villeneuve d’Ascq, Presse du Septentrion, 1999, p. 585.
(8) Jean-Paul BOZONNET, Des monts et des mythes. L’imaginaire social de la montagne, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1992, pp. 39.
(9) Marc BERGÈRE, « Pratique et bilan de l’épuration administrative des officiers de gendarmerie à la Libération », op. cit., p. 199.
