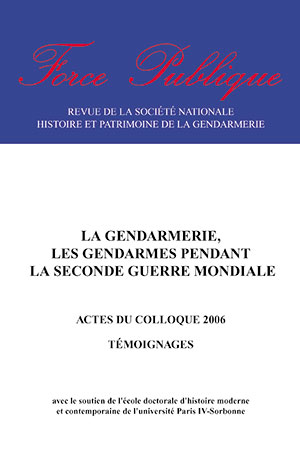
Côte-d’Or, 25 mars 1941 : un gendarme arrête et livre à la Feldgendarmerie de Beaune un prisonnier évadé qui a volé du carburant. Camp de Drancy, été 1942 : des gendarmes maltraitent et spolient des Français et des étrangers de confession juive. Tence (Haute-Loire), automne 1943 : le commandant de la brigade de gendarmerie néglige d’enquêter sérieusement sur la présence d’enfants juifs au Chambon-sur-Lignon, la montagne protestante qui héberge des centaines de réfugiés. Prison de Rennes, décembre 1943 : torturé quotidiennement par les Allemands, le chef d’escadron Maurice Guillaudot, commandant de la gendarmerie du Morbihan et chef de l’Armée secrète de ce département, ne parle pas. Buchenwald, 28 janvier 1945 : le lieutenant Keller meurt, loin de sa section de Saint-Girons (Ariège), où il favorisait la résistance au STO et le passage vers l’Espagne.
Ne retenir que l’une de ces scènes trahit la vérité. Les juxtaposer respecte mieux la réalité, sans, pour autant, totalement l’éclairer. Faut-il s’en étonner quand on sait la complexité du destin de la gendarmerie et de ses personnels pendant les dramatiques années de l’Occupation ? Les exigences du vainqueur et la séparation du pays en plusieurs zones menacent l’existence même d’une force présentée, depuis l’ordonnance organique de 1820, comme « l’une des parties intégrantes de l’armée ». Si la gendarmerie départementale conserve son réseau, malgré les projets allemands, son équipement est limité, tandis que la Garde républicaine mobile disparaît en tant que formation spécifique de l’arme. Dissoute en zone occupée, elle est rattachée, en zone libre, à la direction de la cavalerie, sous le simple nom de Garde, ramenée à 6000 hommes contre un effectif initial de 21 000.

